Le sang total est un tissu vivant qui circule à travers le coeur, les artères, les vaisseaux capillaires et les veines pour y alimenter toutes les cellules humaines en nutriments, électrolytes, hormones, vitamines et oxygène.
Cinquante-cinq pour cent du volume du sang total est constitué de plasma. Formé d'eau à 90 p. cent, le plasma est un liquide clair et riche en protéines. On retrouve dans le plasma un nombre considérable de cellules en suspension : les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Il comprendégalement diverses protéines : l'albumine (sa principale protéine), le fibrinogène et les globulines (incluant les anticorps).
Les cellules du sang se divisent en trois catégories :
Les globules rouges (ou hématies) ont pour fonction le transport de l'oxygène. Une goutte de sang de la grosseur d'une tête d'épingle contient environ 5 millions de globules rouges. Il s'agit de petits disques biconcaves sans noyau dont la couleur rouge est due à une protéine appelée « hémoglobine », une protéine contenant du fer. Chez les femmes, la masse des globules rouges occupe de 37 à 43 % du volume; chez l'homme, elle est de 43 à 49 %.

![]() Les
globules blancs
Les
globules blancs
Un peu plus gros que les globules rouges, les globules
blancs (aussi appelés leucocytes) remplissent diverses
fonctions de purification et de protection contre les
infections. En effet, dès qu'une infection est présente
dans un endroit du corps humain, les globules blancs s'y
rendent pour la combattre. On en retrouve de 6 000 à 8 000
par millimètre cube de sang. Munis d'un noyau, les globules
blancs prennent des formes diverses pendant qu'ils
circulent à travers les vaisseaux et pénètrent toutes les
parties du corps.
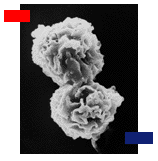
Crédit
photo : Maryvonne Delamaire- ETS Bretagne Est
![]() Les plaquettes
Les plaquettes
Les plaquettes (ou thrombocytes )
sont des cellules sanguines plus petites que les globules.
Les plaquettes ont pour fonction de contribuer à la
coagulation sanguine et à la cicatrisation des plaies. Leur
action coagulatrice démarre lorsqu'un vaisseau sanguin se
fissure : les plaquettes activées se combinent à la
fibrine, dérivée du fibrinogène, pour former un caillot.
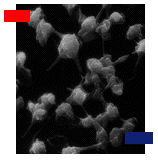
Crédit
photo : Maryvonne Delamaire - ETS Bretagne
Est
Les globules rouges et blancs
ainsi que les plaquettes doivent se renouveler. C'est la
fonction de la moelle osseuse, un tissu mou, gélatineux et
riche en graisse que l'on retrouve dans le centre des os du
corps. Son rôle est de fabriquer ces cellules sanguines.

Les
groupes sanguins
Chez les êtres humains, le groupe sanguin est déterminé en
fonction des substances présentes à la surface des globules
rouges appelés « antigènes ».
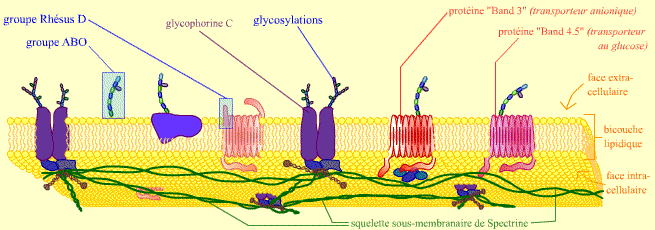
Représentation schématique de la membrane d'une
hématie. Cette membrane possède de
nombreuses protéines membranaires, dont quelques exemples
sont représentés. Ces protéines servent de point d'ancrage
à un important squelette sous-membranaire (formé de
Spectrine), qui donne sa forme au globule rouge. On peut
noter la présence de glycosylations importantes au niveau
de la face extracellulaire, au contact du plasma. Deux
exemples d'antigènes membranaires sont présentés : les
glycosylations (sur des lipides ou des protéines) du groupe
ABO, et l'épitope protéique du groupe Rhésus
D.
Les groupes sanguins sont
regroupés en « systèmes ». Dans le système ABO, il existe
quatre groupes sanguins possibles : A, B, O et AB. Dans le
système Rh, la présence ou l'absence de substance « D » à
la surface du globule rouge détermine si on est Rh positif
(+) ou négatif (-).Dans la population française, les
groupes sanguins se répartissent selon le tableau suivant :

Le tableau suivant résume les compatibilités entre les
différents groupes sanguins des donneurs et des receveurs.
Ainsi, on constate que le groupe O- est destiné à tout le
monde; on l'appelle "donneur universel". On utilisera donc,
entre autres, du sang O- dans les situations d'urgence. À
l'inverse, vous verrez que le groupe AB+ peut recevoir du
sang de tous les groupes sanguins, c'est donc le groupe de
" receveurs universels". Toutefois, dans la majorité des
cas, les receveurs sont transfusés avec le sang d'un
donneur de leur propre groupe sanguin. C'est donc dire
qu'un receveur A+ va recevoir préférentiellement du sang
d'un donneur A+

Antigènes, systèmes antigéniques et groupes sanguins
érythrocytaires
(A, B)
A/IA ou IA/IO
B/IB ou IB/IO
A/IB
O/IO
(Rh +, C, c, E, e)
(K, k)
(Fya, Fyb)
3
(Jka, Jkb)
|
Système |
phénotype antigénique | génotype chromosomique | fréquence dans la population française | |||||
| ABO | A
|
I | 45 %
|
|||||
| B
|
I | 9 %
|
AB
|
I | 4 %
|
O
|
I | 42 %
|
| Rhesus | +
|
D/d ou D/D
|
les associations les plus fréquentes : DCe 42 % DcE 13 % dce 39 % canal transporteur membranaire potentiel |
|||||
| -
|
d/d
|
C, Cc
c Ee, E, e |
Le gène Rhesus CE porte
sur la même séquence les deux déterminants
antigéniques C,c et E,e
canal transporteur membranaire potentiel |
|||||
| Kell | +
|
K/K ou K/k
|
90 %
|
|||||
| -
|
k/k
|
10 %
|
||||||
| Duffy | Fya
|
codominance des allèles a
et b
|
Certaines populations noires n'ont pas l'antigène Duffy, car n'expriment pas la protéine de base nommée AgFy |
|||||
| Fyb
|
Fyab
|
|||||||
| Kidd | Jka
|
codominance des allèles a et b |
Les allèles Jka et Jkb sont chacun présents dans environ 75 % de la population |
Compatibilité dans le système ABO : impératif
transfusionnel
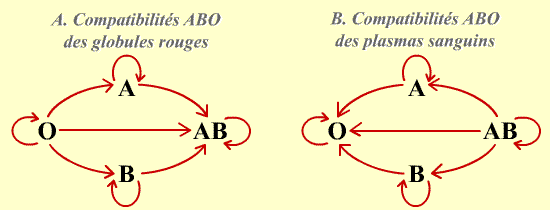
Schémas des compatibilités.
A. Compatibilité ABO des
globules rouges. Les flêches indiquent quelles sont les
transfusions possibles (donneur vers receveur).
Ces
compatibilités supposent l'absence
d'hémolysines
chez les
donneurs.
B. Compatibilité ABO des
plasmas. Même signification des flêches qu'en
A.
Tous droits de reproduction de ce site sont strictement réservés selon la législation sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
